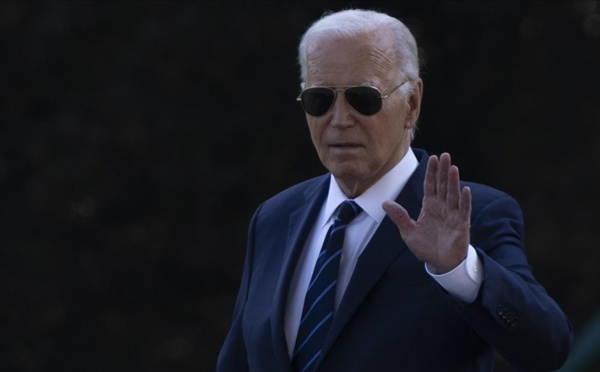Selon l’historien congolais, dans le pays des droits de l’Homme, le récit officiel ne cadre pas avec la réalité. Et l’Afrique francophone ne fait guère mieux.
Depuis de longues années, Elikia M’Bokolo parcourt le monde pour enseigner l’histoire africaine. Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, il déplore le retard de la France dans l’enseignement de l’histoire coloniale. Et celui de l’Afrique francophone.
Jeune Afrique : Comment jugez-vous la manière dont la colonisation et la décolonisation sont enseignées en France ?
Elikia M’Bokolo : Depuis un siècle et demi, l’histoire des ex-pays colonisateurs était présentée dans une perspective nationale, fondée sur la glorification des grands moments. Ce qui concerne les colonies n’était évoqué qu’en annexe. La France célébrait Richelieu, Colbert, les philosophes des Lumières…
On occultait le fait que ces grandes figures nationales étaient par ailleurs liées à l’expansion française, donc à l’histoire coloniale. On feignait d’ignorer que ces héros avaient à voir avec les agissements de la France d’outre-mer, dans les colonies d’Amérique et d’Afrique. De la même manière, on passait sous silence les actions de ces dernières et leurs éventuelles répercussions sur la France.
Plaider pour un enseignement du récit national, comme le suggère François Fillon, candidat à la présidentielle de 2017, serait une régression ?
François Fillon défend l’idée d’une France éternelle, chrétienne, monarchique, qui n’a réalisé que de belles choses. Celle d’aujourd’hui porte en elle le passif de la colonisation – l’immigration, la présence de cultures et de religions multiples –, qui l’oblige à aborder son passé colonial de manière frontale. Il faut être à la hauteur des enjeux de la France d’aujourd’hui. Les échéances électorales semblent commander le contraire. Fillon nous ramène sous la IIIe République de Jules Ferry, très colonialiste.
Avec une France qui justifie sa participation à l’aventure coloniale par la nécessité de faire comme les autres : étendre son empire.
Oui, en assurant que la « Grande France », celle de 1789, de l’Empire, de la IIIe République, de la démocratie et de la laïcité, a été poussée vers l’empire colonial, et qu’elle y a cependant réalisé de belles choses : l’éducation, l’école, la mise en valeur des colonies. Or ça n’a pas toujours été le cas.
Il y a donc une réelle difficulté à parler de ces périodes aux élèves ? Doit-on et peut-on trancher ?
Comment enseigner l’histoire de France sans faire référence à ce qui s’est passé outre-mer ? Comment explorer le siècle de Louis XIV en faisant abstraction du Code noir, adopté à son époque ? Ce sont des questions essentielles que le débat de ces vingt dernières années dans l’Hexagone ne permet malheureusement pas d’aborder dans ses termes les plus clairs. Aujourd’hui, on n’est pas en mesure de décider de façon définitive. Mais on peut au moins convenir que le brio et les splendeurs de Versailles vont de pair avec le Code noir.
Et enseigner ce pan de leur histoire est difficile pour les ex-colonisateurs parce que cela suppose qu’ils endossent le blâme pour les actes inavouables commis alors…
Les enseignements délivrés en France tentent d’accréditer l’idée selon laquelle les colonies africaines ont apporté une contribution décisive à sa victoire pendant la Seconde Guerre mondiale et donc aux idéaux de démocratie, contre le fascisme italien et le nazisme allemand. Le processus d’indépendance leur est-il pour autant lié ? Dans les livres d’histoire, la décolonisation est présentée comme une émanation du conflit mondial.
Mais c’est plus subtil que ça. L’histoire officielle – la Conférence de Brazzaville, l’abolition de l’indigénat – ne cadre pas avec la réalité. La domination coloniale a continué après la guerre, et les Africains ont dû se battre pour faire supprimer le travail forcé, la répression étant parfois sanglante, notamment à Madagascar. En 1944, des soldats sénégalais qui avaient combattu pour la libération de la France ont été massacrés à leur retour à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar.
Ces faits sont-ils évoqués en France ? L’Allemagne le fait…
Depuis les années 1980, les Allemands, qui ont pourtant cessé toute colonisation en 1919, se sont imposé un devoir de mémoire qui les a conduits à reconnaître leurs responsabilités dans des tragédies telles que le génocide en Namibie, les répressions féroces au Tanganyika, la racialisation des populations au Burundi et au Rwanda, qui explique en partie les graves problèmes entre Hutus et Tutsis.
L’Allemagne a aussi entrepris un processus de décolonisation des lieux de mémoire, avec des rues et des places débaptisées au profit de résistants africains. À Londres, la Ghandi Road est une grande avenue. Mais rien de tel pour Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou Amadou Lamine Guèye. La France est en retard. Tout au plus a-t-elle des musées consacrés à cette époque, mais elle ne met en avant aucune personnalité. En 2005, un projet de loi reconnaissant les aspects positifs de la colonisation a été voté. Nous l’avons combattu.
Pour certains, étudier ces périodes, c’est sacrifier à un certain communautarisme.
La France de Léon Gambetta et de Jules Ferry était déjà coloniale. En parler ne signifie pas répondre à un réflexe communautaire, mais admettre que nous avons besoin de discuter de cette France-là. Pour l’abbé Grégoire, la révolution française va de pair avec l’émancipation des juifs et des nègres. Dans son Histoire socialiste de la Révolution française, Jean Jaurès souligne qu’on ne peut pas comprendre cette dernière si on ne met pas en scène la révolution d’Haïti. Nous serions aujourd’hui plus aveugles qu’il y a cent ou deux cents ans ?
Les programmes français se veulent réalistes, avec un certain regard sur la traite négrière et la problématique de l’immigration qui en découle…
Les intentions sont louables. Mais de nombreux professeurs, élevés dans cette culture coloniale, n’ont pas les outils pour délivrer un véritable enseignement. Lors d’ateliers dans le cadre de la journée pour l’abolition de l’esclavage, j’ai entendu des professeurs raconter à leurs élèves que l’esclavage était le fait de Noirs qui vendaient leurs propres frères, les Blancs étant quasi contraints de les acheter pour les sauver. Il y a des efforts à faire sur le contenu des programmes et dans la formation des maîtres.
Et l’Afrique, comment se saisit-elle de ces questions ?
Nous avons de gros problèmes. Depuis les indépendances, nos dirigeants ont une connaissance médiocre, tragiquement nulle de l’histoire de leur propre pays, à commencer par la plus récente, celle de la colonisation. Au Cameroun et au Togo, la colonisation allemande est présentée comme positive. Une absurdité alors que la Namibie a fait reconnaître le génocide des Hereros et des Namas, perpétré à partir de 1904. De nombreux pays d’Afrique francophone s’imaginent que leur histoire commence en 1880 avec Pierre Savorgnan de Brazza ou la « mission civilisatrice » de Jules Ferry.
Devoir sur table : « Un mal nécessaire »
«La traite négrière a été un mal nécessaire pour l’Afrique. Démontre-le par deux raisons. » Lorsque son fils de 12 ans, en classe de quatrième au collège privé Descartes, rapporte ce devoir dans leur maison de Lomé un jour de mai 2016, le sang du journaliste Tony Feda ne fait qu’un tour : « Je suis allé rencontrer l’enseignant, qui m’a appris que cet aspect apparaissait au chapitre “Conséquences” [de la traite]. Et qu’il y a le même apprentissage en classe de troisième concernant la colonisation. »
Dépourvu de livres d’histoire, le professeur se fonde sur les directives de l’Inspection académique et sur un programme « datant de la réforme de l’enseignement de 1975, poursuit le journaliste. Le chapitre “Conséquences” a été divisé en deux parties, “avantages” et “inconvénients”. » Ainsi, la colonisation aurait été « une bonne chose au Togo, en donnant au pays le statut de colonie modèle [Münsterkolonie] », s’indigne ce père de famille. (M.P)
Jeune Afrique
Depuis de longues années, Elikia M’Bokolo parcourt le monde pour enseigner l’histoire africaine. Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, il déplore le retard de la France dans l’enseignement de l’histoire coloniale. Et celui de l’Afrique francophone.
Jeune Afrique : Comment jugez-vous la manière dont la colonisation et la décolonisation sont enseignées en France ?
Elikia M’Bokolo : Depuis un siècle et demi, l’histoire des ex-pays colonisateurs était présentée dans une perspective nationale, fondée sur la glorification des grands moments. Ce qui concerne les colonies n’était évoqué qu’en annexe. La France célébrait Richelieu, Colbert, les philosophes des Lumières…
On occultait le fait que ces grandes figures nationales étaient par ailleurs liées à l’expansion française, donc à l’histoire coloniale. On feignait d’ignorer que ces héros avaient à voir avec les agissements de la France d’outre-mer, dans les colonies d’Amérique et d’Afrique. De la même manière, on passait sous silence les actions de ces dernières et leurs éventuelles répercussions sur la France.
Plaider pour un enseignement du récit national, comme le suggère François Fillon, candidat à la présidentielle de 2017, serait une régression ?
François Fillon défend l’idée d’une France éternelle, chrétienne, monarchique, qui n’a réalisé que de belles choses. Celle d’aujourd’hui porte en elle le passif de la colonisation – l’immigration, la présence de cultures et de religions multiples –, qui l’oblige à aborder son passé colonial de manière frontale. Il faut être à la hauteur des enjeux de la France d’aujourd’hui. Les échéances électorales semblent commander le contraire. Fillon nous ramène sous la IIIe République de Jules Ferry, très colonialiste.
Avec une France qui justifie sa participation à l’aventure coloniale par la nécessité de faire comme les autres : étendre son empire.
Oui, en assurant que la « Grande France », celle de 1789, de l’Empire, de la IIIe République, de la démocratie et de la laïcité, a été poussée vers l’empire colonial, et qu’elle y a cependant réalisé de belles choses : l’éducation, l’école, la mise en valeur des colonies. Or ça n’a pas toujours été le cas.
Il y a donc une réelle difficulté à parler de ces périodes aux élèves ? Doit-on et peut-on trancher ?
Comment enseigner l’histoire de France sans faire référence à ce qui s’est passé outre-mer ? Comment explorer le siècle de Louis XIV en faisant abstraction du Code noir, adopté à son époque ? Ce sont des questions essentielles que le débat de ces vingt dernières années dans l’Hexagone ne permet malheureusement pas d’aborder dans ses termes les plus clairs. Aujourd’hui, on n’est pas en mesure de décider de façon définitive. Mais on peut au moins convenir que le brio et les splendeurs de Versailles vont de pair avec le Code noir.
Et enseigner ce pan de leur histoire est difficile pour les ex-colonisateurs parce que cela suppose qu’ils endossent le blâme pour les actes inavouables commis alors…
Les enseignements délivrés en France tentent d’accréditer l’idée selon laquelle les colonies africaines ont apporté une contribution décisive à sa victoire pendant la Seconde Guerre mondiale et donc aux idéaux de démocratie, contre le fascisme italien et le nazisme allemand. Le processus d’indépendance leur est-il pour autant lié ? Dans les livres d’histoire, la décolonisation est présentée comme une émanation du conflit mondial.
Mais c’est plus subtil que ça. L’histoire officielle – la Conférence de Brazzaville, l’abolition de l’indigénat – ne cadre pas avec la réalité. La domination coloniale a continué après la guerre, et les Africains ont dû se battre pour faire supprimer le travail forcé, la répression étant parfois sanglante, notamment à Madagascar. En 1944, des soldats sénégalais qui avaient combattu pour la libération de la France ont été massacrés à leur retour à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar.
Ces faits sont-ils évoqués en France ? L’Allemagne le fait…
Depuis les années 1980, les Allemands, qui ont pourtant cessé toute colonisation en 1919, se sont imposé un devoir de mémoire qui les a conduits à reconnaître leurs responsabilités dans des tragédies telles que le génocide en Namibie, les répressions féroces au Tanganyika, la racialisation des populations au Burundi et au Rwanda, qui explique en partie les graves problèmes entre Hutus et Tutsis.
L’Allemagne a aussi entrepris un processus de décolonisation des lieux de mémoire, avec des rues et des places débaptisées au profit de résistants africains. À Londres, la Ghandi Road est une grande avenue. Mais rien de tel pour Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou Amadou Lamine Guèye. La France est en retard. Tout au plus a-t-elle des musées consacrés à cette époque, mais elle ne met en avant aucune personnalité. En 2005, un projet de loi reconnaissant les aspects positifs de la colonisation a été voté. Nous l’avons combattu.
Pour certains, étudier ces périodes, c’est sacrifier à un certain communautarisme.
La France de Léon Gambetta et de Jules Ferry était déjà coloniale. En parler ne signifie pas répondre à un réflexe communautaire, mais admettre que nous avons besoin de discuter de cette France-là. Pour l’abbé Grégoire, la révolution française va de pair avec l’émancipation des juifs et des nègres. Dans son Histoire socialiste de la Révolution française, Jean Jaurès souligne qu’on ne peut pas comprendre cette dernière si on ne met pas en scène la révolution d’Haïti. Nous serions aujourd’hui plus aveugles qu’il y a cent ou deux cents ans ?
Les programmes français se veulent réalistes, avec un certain regard sur la traite négrière et la problématique de l’immigration qui en découle…
Les intentions sont louables. Mais de nombreux professeurs, élevés dans cette culture coloniale, n’ont pas les outils pour délivrer un véritable enseignement. Lors d’ateliers dans le cadre de la journée pour l’abolition de l’esclavage, j’ai entendu des professeurs raconter à leurs élèves que l’esclavage était le fait de Noirs qui vendaient leurs propres frères, les Blancs étant quasi contraints de les acheter pour les sauver. Il y a des efforts à faire sur le contenu des programmes et dans la formation des maîtres.
Et l’Afrique, comment se saisit-elle de ces questions ?
Nous avons de gros problèmes. Depuis les indépendances, nos dirigeants ont une connaissance médiocre, tragiquement nulle de l’histoire de leur propre pays, à commencer par la plus récente, celle de la colonisation. Au Cameroun et au Togo, la colonisation allemande est présentée comme positive. Une absurdité alors que la Namibie a fait reconnaître le génocide des Hereros et des Namas, perpétré à partir de 1904. De nombreux pays d’Afrique francophone s’imaginent que leur histoire commence en 1880 avec Pierre Savorgnan de Brazza ou la « mission civilisatrice » de Jules Ferry.
Devoir sur table : « Un mal nécessaire »
«La traite négrière a été un mal nécessaire pour l’Afrique. Démontre-le par deux raisons. » Lorsque son fils de 12 ans, en classe de quatrième au collège privé Descartes, rapporte ce devoir dans leur maison de Lomé un jour de mai 2016, le sang du journaliste Tony Feda ne fait qu’un tour : « Je suis allé rencontrer l’enseignant, qui m’a appris que cet aspect apparaissait au chapitre “Conséquences” [de la traite]. Et qu’il y a le même apprentissage en classe de troisième concernant la colonisation. »
Dépourvu de livres d’histoire, le professeur se fonde sur les directives de l’Inspection académique et sur un programme « datant de la réforme de l’enseignement de 1975, poursuit le journaliste. Le chapitre “Conséquences” a été divisé en deux parties, “avantages” et “inconvénients”. » Ainsi, la colonisation aurait été « une bonne chose au Togo, en donnant au pays le statut de colonie modèle [Münsterkolonie] », s’indigne ce père de famille. (M.P)
Jeune Afrique








 ACCUEIL
ACCUEIL